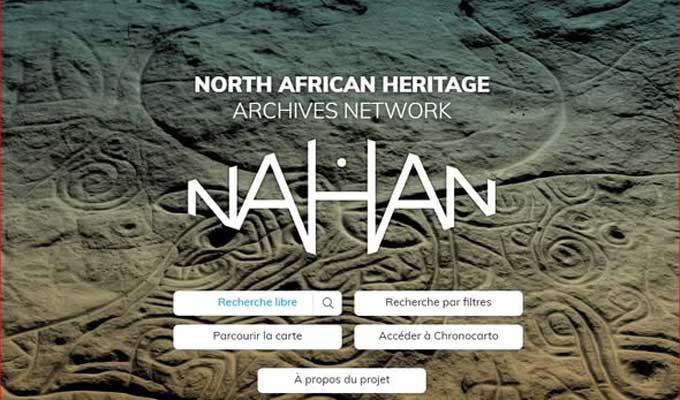
En accès livre depuis 2023, Nahan a été développée sous la direction technique du laboratoire français AOROC (Archéologie et Philologie d’Orient et d’Occident, CNRS-ENS-PSL).
Utilisant des modules de traduction automatique, la plateforme est disponible en français, anglais, allemand, espagnol, italien et arabe. L’ensemble des contenus sera progressivement traduit d’ici fin décembre avec la localisation des objets et des institutions d’archives.
Ce projet a été présenté dans le cadre du colloque international sur “la coopération archéologique tuniso-française : nouvelles orientations, nouveaux résultats” tenu les 23 et 24 octobre à Gammarth, en présence d’experts en patrimoine et archéologues tunisiens et français. L’évènement organisé à l’initiative de l’Institut français de Tunisie (IFT), se déroule en partenariat avec l’Institut national du Patrimoine (INP) et l’Agence de mise en valeur du Patrimoine et de Promotion culturelle (AMVPPC).
Intervenant par visioconférence, le chercheur français Christophe J. Godard (CNRS-ENS-PSL, AOROC, UMR 8546, Paris), a présenté les grandes lignes de ce Projet élabore en 2020 sous l’égide de l’ICCROM (International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property / UNESCO).
Il a expliqué le mode de navigation et d’usage des données mise en ligne, régies par un cadre juridique bien clair et consultables à l’adresse suivante : https://nahan.huma-num.fr/.
Fruit d’un dialogue entamé en 2016 entre plusieurs institutions archéologiques du Maghreb, notamment la Tunisie, et leurs partenaires européens (près de 20 aujourd’hui), la plateforme rassemble plus 48 000 données issues des archives numérisées conservées par chaque institution participante. Elle vise à valoriser et conserver numériquement les archives archéologiques pour mes générations futures et les chercheurs travaillant sur des sites historiques, y compris ceux issus d’anciennes coopérations remontant à la période coloniale.
Pour les institutions ne disposant pas de leur propre serveur, les bases de données nationales françaises peuvent être utilisées pour le dépôt numérique des documents. Cependant, chaque institution est responsable de la qualité de ses documents et en conserve l’intégralité de ses droits d’auteur et de ses copyrights.
Toujours en développement, la plateforme s’appuie sur des métadonnées pour agréger des données multisites et des documents déjà disponibles en ligne. Elle permet également de référencer des entrées de catalogue lorsque les documents n’ont pas encore été numérisés.
En 2025, la plateforme a intégré de nouveaux outils : un module épigraphique, un module de traduction automatique des notices, un module cartographique via chronocarto.eu, ainsi qu’un système de géolocalisation des données archéologiques du Maghreb (photos, archives, rapports) incluant des détails sur la source et l’auteur.
Selon Christophe J.Godard, le principal défi reste la question de la propriété à plusieurs niveaux : celle du chercheur, de l’institution et parois du pays. Une amélioration de la localisation cartographique des sites partenaires est prévue d’ici février 2026, afin d’offrir une recherche plus fluide par type de document, éditeur ou pays.




