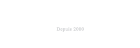La Tunisie dispose d’un patrimoine agricole exceptionnel, mais sa richesse reste prisonnière d’un système fragmenté et vulnérable : filières désarticulées, stress hydrique, faiblesse de la transformation locale, manque d’outils financiers et absence de transparence des prix.
Face à ces freins structurels, ce plaidoyer propose la création d’une Bourse Verte des Commodités Agricoles, conçue comme une plateforme publique-privée de fixation des prix, de contractualisation et de traçabilité environnementale.
Soutenue par des instruments financiers innovants (contrats à terme, warrants, green bonds, certificats carbone et hydriques), cette Bourse donnerait aux producteurs des revenus sécurisés, aux investisseurs des flux transparents, et à l’État un levier fiscal équitable avec la formalisation des échanges.
Le Corridor ELMED (interconnexion Tunisie–Italie) viendrait renforcer ce dispositif en fournissant une énergie verte compétitive, indispensable au dessalement, à la transformation agroalimentaire et à la conservation des récoltes.
La filière huile d’olive, déjà reconnue au niveau international, peut servir de projet pilote pour démontrer l’efficacité de cette approche, avant son extension aux agrumes, amandes, figues de barbarie, dattes, etc.
En réinventant la gouvernance, la traçabilité et le financement agricoles à l’aune du Nexus WEFE(Water–Energy–Food–Ecosystems), la Tunisie a l’opportunité de devenir le premier hub africain de la finance verte agricole et un modèle reproductible de durabilité circulaire.
I. Le paradoxe agricole tunisien
La Tunisie est à la fois une terre d’abondance et de contradictions. Depuis l’Antiquité, son terroir est célébré pour la richesse de son oléiculture millénaire et la diversité de ses productions agricoles. Aujourd’hui encore, elle conserve son rang de premier producteur mondial d’huile d’olive biologique, un label qui lui ouvre les portes des marchés européens, nord-américains et asiatiques.
Et pourtant, cette réussite emblématique masque une réalité beaucoup moins valorisante : la faible capture de valeur. Hormis la part conditionnée destinée au marché bio et premium, près de 85% des exportations d’huile d’olive tunisienne quittent encore le pays en vrac, sans indication géographique ni traçabilité.
La plupart des étapes de valorisation, raffinage, conditionnement, embouteillage, labellisation carbone ou d’origine, sont réalisées à l’étranger. Du coup, quand bien même la filière reste excédentaire en devises, elle ne capte pas toute la valeur ajoutée et peine à offrir aux producteurs une rémunération équitable ou à attirer des investissements structurants en aval.
Une agriculture encore marquée par la précarité structurelle
Cette fuite de valeur ne se limite pas à l’oléiculture. Elle traverse aussi d’autres filières stratégiques, comme les agrumes, les amandes, les abricots, les plantes aromatiques et médicinales (PAM), les dattes, les tomates, etc(voir encadré ci-après). Ces filières partagent les mêmes handicaps, à savoir :
- Asymétrie d’information entre producteurs et acheteurs.
- Faible intégration logistique (stockage, conditionnement, chaîne du froid).
- Accès limité au financement pour les petits exploitants.
- Prix instables et vulnérabilité accrue face au changement climatique.
Un paradoxe à transformer en opportunité
La Tunisie dispose pourtant d’atouts considérables :
- un savoir-faire agricole séculaire,
- un climat méditerranéen diversifié,
- une proximité avec l’Europe et l’Afrique,
- et surtout une jeunesse avide d’innovation et d’entrepreneuriat vert.
Le véritable paradoxe tunisien est donc le suivant : un potentiel agricole exceptionnel, mais une structuration défaillante des filières. S’il est bien exploité, ce contraste peut devenir un levier de transformation systémique, ouvrant la voie à une agriculture compétitive, inclusive et résiliente.
Quelques chiffres clés des principales filières agricoles tunisiennes
Huile d’olive : ~220 000 t produites en 2023/24 ; jusqu’à 340 000 t attendues en 2024/25.
- Plus de 85 % des exportations en vrac, seulement 14–15 % conditionnées.
- Empreinte carbone : ~1,5–2,0 kg CO₂e/L (variable selon pratiques et énergie – IOC, 2021).
- Empreinte hydrique : ~3 000–4 400 L d’eau/L d’huile (WFN, 2019).
Agrumes (oranges, etc.) : ~360 000 t produites en 2023/24 (+25 % vs saison précédente). - Exportations limitées : 12 455 t en 2025.
- Empreinte carbone : ~0,35–0,40 kg CO₂e/kg d’oranges (FAO, 2020).
- Empreinte hydrique : ~560–700 L/kg (WFN, 2019).
Amandes : ~70 000 t/an (2022, FAO) .
- Faible transformation locale, valeur souvent perdue sur les marchés internationaux.
- Empreinte carbone : ~0,8–1,0 kg CO₂e/kg (FAOSTAT, 2020).
- Empreinte hydrique : très élevée, ~16 000 L/kg d’amandes décortiquées (WFN, 2019).
Abricots : ~37 000 t/an (2022, FAO) .
- Potentiel important pour la 4ᵉ gamme (jus, surgelés, séchage) non exploité.
- Empreinte carbone : ~0,3–0,4 kg CO₂e/kg (LCA – Eurostat, 2020).
- Empreinte hydrique : ~1 200 L/kg (WFN, 2019).
Figues de barbarie (cactus) : ~600 000 ha cultivés, Tunisie = 2ᵉ producteur mondial.
- Fort potentiel dans les cosmétiques (huile de pépins) mais structuration industrielle limitée.
- Empreinte carbone : très faible, ~0,15–0,20 kg CO₂e/kg (ICARDA, 2021).
- Empreinte hydrique : très faible, ~180–250 L/kg de fruits (WFN, 2018).
Plantes aromatiques et médicinales (PAM) : >500 espèces recensées.
- 85–90 % collectées à l’état sauvage, sans organisation ni traçabilité.
- Empreinte carbone : ~0,2–0,3 kg CO₂e/kg de biomasse sèche (moyenne méditerranéenne – FAO, 2020).
- Empreinte hydrique : ~500–800 L/kg selon l’espèce (WFN, 2019).
Dattes (Deglet Nour, etc.) : Tunisie = 2ᵉ exportateur mondial.
- 2024/25 : ~108 000 t exportées (≈687 MDT), dont 6 700 t de bio (≈59,5 MDT).
- Filière énergivore et hydrovore (~20 000 m³/ha pour Deglet Nour).
- Empreinte carbone : ~0,6–0,8 kg CO₂e/kg (ICARDA, 2022).
- Empreinte hydrique : ~2 800–3 500 L/kg (WFN, 2019).
Tomates (fraîches, concentrées, séchées) :
- Production annuelle : ~1,2 million de tonnes (filière stratégique).
- Transformées : ~250–300 000 t en concentré, dont une part exportée vers l’Europe et l’Afrique.
- Tomates séchées : spécialité tunisienne en croissance, ~15–20 000 t exportées par an.
- Empreinte carbone :
- Tomate fraîche : ~0,2–0,3 kg CO₂e/kg,
- Tomate concentrée : ~0,6–0,7 kg CO₂e/kg,
- Tomate séchée (séchage conventionnel) : jusqu’à 2 kg CO₂e/kg (FAO, 2020).
- Empreinte hydrique : ~200 L/kg (frais) à 1 600 L/kg (séché – WFN, 2019).
- Forte valeur ajoutée potentielle via l’énergie solaire (séchage dé-carboné) et la certification durable.
CHIFFRES CLÉS
- 85 % — part des exportations d’huile d’olive tunisienne expédiée en vrac.
- 400 m³/hab/an — disponibilité en eau douce, seuil de rareté absolue.
- 30 % — part de l’énergie dans le coût de production irriguée.
- 35 % — objectif d’énergies renouvelables dans l’agriculture d’ici 2035.
- 10–12 % — contribution du secteur agricole au PIB national.
II. Pourquoi le Nexus WEFE comme nouveau référentiel stratégique
À l’heure où les systèmes agricoles sont confrontés à une triple crise -climatique, économique et sociale-la Tunisie ne peut plus penser son avenir agricole dans des logiques sectorielles cloisonnées. Adopter une approche systémique peut aider à relier les ressources, les usages et les acteurs de manière cohérente et durable. Et c’est précisément ce que propose le Nexus WEFE : une grille de lecture intégrée qui articule Eau, Énergie, Alimentation et Écosystèmes dans une dynamique circulaire.
A) Une interdépendance croissante entre les ressources
L’agriculture tunisienne illustre pleinement les tensions du Nexus WEFE:
- L’eau, rare et surexploitée, indispensable à l’irrigation mais aussi à la transformation agroalimentaire. La Tunisie est aujourd’hui classée parmi les pays en stress hydrique extrême, avec moins de 400m³ d’eau douce renouvelable par habitant et par an, bien en deçà du seuil de rareté absolue (1 000 m³).
- L’énergie, indispensable au pompage, au dessalement, au conditionnement et à la logistique. Les coûts énergétiques représentent parfois jusqu’à 30 % du coût de production dans certaines filières irriguées.
- La sécurité alimentaire, enjeu stratégique, dépend directement de la résilience de ces deux ressources. Une hausse du prix du pétrole ou une sécheresse prolongée peut déstabiliser l’ensemble de la chaîne agroalimentaire.
- Les écosystèmes (sols, biodiversité, couverture végétale), qui assurent des fonctions vitales : régénération, pollinisation, stockage hydrique et capture du carbone. Leur dégradation fragilise tout le système productif.
Ces dimensions ne peuvent plus être pensées isolément. Toute intervention sur l’une affecte les autres: développer l’irrigation sans énergies renouvelables aggrave la dépendance énergétique; intensifier la production sans préserver les sols accélère l’érosion et la désertification. La durabilité exige désormais une gestion concertée et intégrée du Nexus.
B) Une logique circulaire face au changement climatique
Le Nexus WEFE n’est pas seulement une contrainte : il ouvre une opportunité de régénération. Il invite à concevoir des modèles agricoles :
- Qui réutilisent les eaux usées traitées pour l’irrigation.
- Qui s’appuient sur des énergies vertes (solaire, éolien, biomasse) pour l’agro-transformation.
- Qui valorisent les coproduits agricoles en biofertilisants, composts ou biogaz.
- Qui réhabilitent les terres dégradées grâce à l’agroforesterie et à la gestion durable des bassins versants.
En intégrant ces logiques, la Tunisie peut passer d’une agriculture extractive à une agriculture circulaire, bas carbone et résiliente.
Elle peut aussi créer de nouveaux débouchés commerciaux adaptés aux exigences internationales comme la traçabilité environnementale, le Zéro Carbone et le Carbon Border Adjustment Mechanism(CBAM)de l’Union européenne.
C) Le Nexus comme boussole pour les politiques agricoles
Plus qu’un concept théorique, le Nexus WEFE doit devenir le référentiel stratégique des politiques agricoles et rurales tunisiennes.
Il permet de dépasser la vision productiviste et linéaire pour construire des territoires nourriciers interconnectés, où les infrastructures, les institutions et les innovations sont pensées ensemble, dans une cohérence avec les Objectifs de Développement Durable (ODD).
La Tunisie a aujourd’hui l’opportunité de se positionner comme pays pionnier en Méditerranée d’un modèle agricole nexus-compatible.
Mais ce saut qualitatif suppose une refondation profonde de ses outils de gouvernance, de financement et de contractualisation — qui seront exposés en détail dans ce qui suit.
Indicateurs Nexus WEFE en Tunisie
Eau
- Ressources renouvelables : ≈ 4,6 km³/an, soit < 400 m³/habitant/an → seuil de rareté absolue (< 1 000m³).
- Agriculture : consomme 80 % de l’eau disponible.
- Perte par évaporation dans les périmètres irrigués : jusqu’à 30 %.
Énergie
- Part des énergies fossiles dans l’irrigation et la transformation agroalimentaire : > 90 %.
- Part de l’énergie dans le coût de production agricole irriguée : 20–30 % selon les cultures.
- Cible nationale : 35 % d’énergies renouvelables en 2035 (contre ~3–5 % actuellement dans l’agriculture).
Alimentation
- Dépendance aux importations céréalières : 50–60 % (blé tendre presque entièrement importé).
- Contribution du secteur agricole au PIB : ≈ 10–12 %. Emploi : ≈ 15 % de la population active.
Écosystèmes
- Superficie des sols menacés de désertification : ≈ 75 % du territoire.
- Couverture forestière : 6,6 % du territoire (contre >30 % moyenne méditerranéenne).
- Biodiversité agricole : plus de 500 espèces de PAM recensées, mais 85–90 % collectées en mode sauvage.
Par Mondher Khanfir, Conseiller en Politique Publique
EN BREF
- La Tunisie veut créer une Bourse Verte des Commodités Agricoles pour formaliser et financer durablement ses filières.
- Objectif : assurer des revenus stables, une traçabilité environnementale et une transparence des prix.
- Le Corridor ELMED doit fournir l’énergie verte nécessaire à la transformation locale.
- Le Nexus WEFE (Eau-Énergie-Alimentation-Écosystèmes) devient la nouvelle boussole stratégique.
- L’huile d’olive servira de projet pilote, avant extension à d’autres produits agricoles.
Lire aussi dans le Document complet ci-après :
- L’innovation écosystémique : un nouveau pacte pour les chaînes de valeur agricoles
- IV. Le Corridor ELMED comme catalyseur d’une rupture systémique
- V. + VI. La Bourse Verte des commodités : un levier structurant
- VII. Le cas de la filière huile d’olive : impacts attendus du champ à l’assiette
- VIII. Recommandations politiques