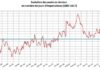Mohamed est le patron d’un café à Douar Hicher. Pour lui, il ne fait aucun doute que l’image que l’on donne de son quartier est archifausse: «Ce ne sont pas les salafistes qui font la loi, mais la violence, la misère, l’anarchie… Depuis la révolution, personne n’ose s’aventurer ici. Rien n’a changé. C’est tout simplement pire!».
La révolution a exacerbé dans ces quartiers la haine de l’autorité. Organisés en quartiers selon une recomposition tribale ou régionale, la population vit sur le fil du rasoir. A la colère d’avant est venue se rajouter une énorme déception. Celle de penser que la révolution n’a pas servi à grand-chose.
Il n’y a pas que les populations des régions qui sont déçues. Les déçus et marginaux de ces quartiers aussi portent en eux une grande rancœur. Installés dans les faubourgs de Tunis par une politique défaillante d’exode rurale, ils sont juste conscients qu’ils peuvent mettre Tunis à feu et à sang. Ils ont davantage conscience que l’explosion de leur colère peut dangereusement peser sur l’avenir.
Cette ceinture qui étrangle la capitale est, nous dit-on, le deuxième bidonville d’Afrique. Des chiffres pas du tout officiels parlent de 800.000 habitants. Combien sont-ils devenus aujourd’hui près de 22 mois après le 14 janvier 2011? A l’époque, l’exode était considéré comme une soupape pour contenir la contestation des régions. A une centaine de kilomètres plus loin, Fatma BM se souvient: «A chaque fois qu’il y avait une large contestation du côté de Kasserine, le système Ben Ali inondait Bizerte sans crier gare! Ces gens délogés et déracinés sont lâchés sans dispositifs ni encadrements. On connaît la suite».
A Douar Hicher, comme Mohamed, nombreux sont convaincus que «si la révolte explose à nouveau, cette fois il ne restera rien de Tunis et de ses quartiers huppés. La colère et le ressentiment sont tels que tout brûlera…».
Le café de Mohamed se trouve à côté du seul poste de police encore en fonction. Les autres, bien que reconstruits et repeints après les événements, sont transformés en dépotoirs. Les forces de l’ordre en position, jeunes et bien habillés, paraissent bien frêles dans cet environnement explosif.
Le quartier de Douar Hicher, scène d’affrontements violents ayant abouti à la mort de jeunes salafistes la semaine écoulée, regroupe plus de 130.000 habitants. Au terme d’une journée de rencontres, il ressort que tout s’y tient dans une forme de désordre.
Rien à voir avec les quartiers Echabeb, Khaled Ibn El Oualid, les rues 155 ou 156… «Dans la partie basse du quartier, on se connaît presque tous et nous avons grandi ensemble», nous dit notre accompagnateur. Il se détournera pourtant de sa trajectoire à plusieurs reprises, précisant que ce sont des quartiers peu sûrs et qu’il ne pourra répondre de notre sécurité.
Soudain, l’appel à la prière retentit. Des groupes de jeunes se pressent le pas et Mohamed rajoute: «Ils font campagne au Jihad ouvertement. Ils passent en boucle des prêches d’une grande violence. Il y a des gens pieux sur qui ils n’ont aucune influence mais ce sont les jeunes qui se font enrôler».
Evidement les questions finissent par tomber. D’où viennent ces salafistes? Qui sont-ils? Que peuvent-ils? «Ne prenez pas le même ton et n’adoptez pas la même version de ceux qui ne font pas l’effort de comprendre. Ceux qui sont les plus démonstratifs et bruyants étaient là depuis Ben Ali. Beaucoup de voyous, d’anciens prisonniers portent des kamis et se laissent pousser des barbes et, depuis les affrontements de l’aïd, celles-ci sont nettement plus courtes», dit Mohamed avec entrain. Il nommera un à un les grandes figures du banditisme d’hier reconverties en salafistes d’aujourd’hui.
N’en déplaise à la version rose et dosée que l’on veut bien vendre, il n’en reste pas moins vrai que les salafistes sont bel et bien là. Ils font profil bas jusqu’à la prochaine explosion. S’il est fort probable que des armes circulent, ce qui est certain c’est que l’endoctrinement des jeunes sans espoirs de lendemains meilleurs peut faire d’eux des armes de destruction massive. Ces jeunes bouffis par le chômage et le vide ayant vécu dans l’indigence et goûté à la délinquance sont des proies faciles. «En 3 à 5 mois, mon frère a changé. Il refuse d’écouter de la musique, se coupe totalement de tous et de tout. Je ne donnerais pas cher de sa peau. Un jour, il s’explosera ici ou mourra au jihad en Syrie», dira Monia à propos de son jeune frère.
Voltaire ne disait-il pas que «Rien ne sera plus dangereux que lorsque l’ignorance et l’intolérance sont armées de pouvoirs». Car le pouvoir provient dans ces quartiers des commerces illicites et des trafics en tous genres. Commerçant avec la drogue ou la religion, ces «nababs» d’un jour maintiennent une économie prohibitive qui vient appuyer les petits métiers permettant de boucler des fins de mois difficiles.
Ayman vit au «Bortal». Il passe d’un quartier à l’autre avec la même souplesse. Gai et débrouillard, le jeune homme tient des propos crus: «Ne vous faites pas d’illusion. Le trafic se fait avec la drogue, les antidépresseurs, la religion, sa propre sœur… Ici à partir de 19h00, un monde se couche et un autre se lève».
A certains carrefours, des jeunes entre 16 et 20 ans sont dealers. Ils vendent des anxiolytiques, des antidépresseurs, du viagra… «Je peux vous obtenir tout ce que vous voulez», assure Aymen qui annonce les prix : «3 dinars le cachet de Tranxcène, 2 dinars pour le Témesta, 1.000 dinars le kilo de résine de cannabis».
Selon ses dires, ce sont des médicaments qui proviennent de vols à l’hôpital psychiatrique de La Manouba. Concernant «la zatla», celle-ci est acheminée depuis l’Algérie ou des plantations autour de Sidi Bouzid. «Le cannabis n’est pas prohibé par le Coran mais par la loi, et ici, c’est le Coran qui prime», dit-il en laissant entendre que les salafistes ne sont pas étrangers à la prolifération de drogue dans le quartier alors qu’ils combattent l’usage et la vente d’alcool.
La nuit arrive et nos accompagnateurs préfèrent nous ramener. «La violence est là; la nuit, lorsque la trêve du jour est suspendue, certains quartiers un “No man’s land“ règne du hors-la-loi», explique Aymen. Négociant une prochaine immersion, on laisse le quartier à tous ces business.
Tant que règnera la précarité et l’ignorance, Douar Hicher, Ettadhamen ou Al Kabaria resteront de véritables poudrières. Jusqu’à quand?