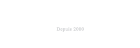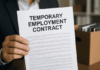Une réforme ambitieuse, mais au coût élevé
Promulgué en mai 2025, le nouveau Code du travail tunisien marque une refonte profonde de la législation sociale. Plusieurs articles (6-2, 6-3, 6-4, 17 et le premier alinéa de 94-2) ont été abrogés et remplacés par de nouvelles dispositions, selon un processus que beaucoup jugent complexe et incertain.
L’objectif, noble sur le papier, est de lutter contre la précarité et d’assurer un emploi stable et décent. Mais cette réforme inquiète fortement le secteur privé, notamment les PME industrielles et de services, déjà fragilisées par un accès au crédit limité, un faible autofinancement et une grande exposition aux chocs économiques.
L’arrêté du 23 septembre : une obligation jugée insoutenable
Le 23 septembre 2025, le ministère des Affaires sociales a publié un arrêté d’application du chapitre 30 de la loi n°9 du 21 mai 2025. Ce texte impose à toutes les entreprises sous-traitantes de déposer une garantie financière auprès d’une banque, destinée à couvrir le paiement des salaires et des cotisations sociales en cas de défaillance.
Le montant de cette caution est fixé à 20 % de la valeur totale du contrat, à déposer dans les trois jours suivant la signature. Une mesure jugée irréaliste par de nombreux observateurs.
« Aucune PME ne peut immobiliser une telle somme sur la durée d’un contrat », alerte un expert en droit du travail.
Avec des taux d’intérêt élevés, des garanties bancaires exigeantes et peu de dispositifs d’appui, cette disposition risque de fermer l’accès au marché à une grande partie des petites structures.
Un dispositif en décalage avec les pratiques internationales
La Tunisie se démarque ici par une exigence inhabituelle. Dans la plupart des pays, la garantie financière pour les marchés publics ou privés varie entre 3 et 5 %, rarement au-delà de 10 %.
En fixant un seuil de 20 %, Tunis s’isole de la norme mondiale et suscite des interrogations économiques et juridiques. D’autres législations préfèrent des dispositifs proportionnels à la masse salariale ou à un mois de rémunération, afin d’éviter de pénaliser la trésorerie des entreprises.
Une distorsion de concurrence au profit des grands groupes
Au-delà du choc financier, cette mesure pourrait transformer la structure concurrentielle du marché. Les grandes entreprises, mieux capitalisées, absorberont facilement cette contrainte. Les PME, elles, devront revoir leurs prix à la hausse ou renoncer à des contrats.
Ce déséquilibre favorisera la concentration du marché, réduira la diversité des acteurs économiques et transformera une mesure sociale en barrière à l’entrée. Plusieurs experts craignent aussi que les grands donneurs d’ordre exploitent ce rapport de force pour imposer des conditions abusives aux petits prestataires.
Les banques, gagnantes de la réforme
Paradoxalement, les principaux bénéficiaires de cette disposition pourraient être les banques. Leur rôle dans la gestion des garanties leur procure une source de revenus supplémentaire, sans prise de risque réelle.
Les PME se retrouvent ainsi prises en étau entre exigences bancaires et délais administratifs, alors même que l’intention initiale du texte était de sécuriser les salariés.
Vers une nécessaire révision du dispositif
Face aux critiques, plusieurs pistes de réajustement émergent. Des experts suggèrent de lier la garantie à la masse salariale plutôt qu’à la valeur du contrat, ou de plafonner le taux à 5 % pour les PME.
D’autres préconisent la mise en place d’un fonds de garantie sectoriel, mutualisé entre entreprises, pour concilier protection sociale et viabilité économique.
Trouver le juste équilibre
En voulant protéger les travailleurs, l’État risque de fragiliser le tissu entrepreneurial. L’arrêté du 23 septembre 2025, louable dans son intention, semble déconnecté de la réalité économique tunisienne.
Sans ajustement, il pourrait affaiblir la compétitivité nationale, accentuer la concentration des marchés et freiner l’initiative privée, notamment celle des jeunes entrepreneurs.
Protéger les salariés et préserver les entreprises ne sont pas des objectifs opposés. Encore faut-il que la réglementation sache, selon la formule de Winston Churchill, reconnaître dans l’entrepreneur non pas « une vache à traire », mais « le cheval qui tire le char ».
Amel Belhadj Ali
EN BREF
- Le nouveau Code du travail impose une garantie bancaire de 20 % pour les sous-traitants.
- Objectif : sécuriser le paiement des salaires en cas de défaillance.
- Les PME dénoncent une contrainte financière insoutenable.
- Le taux dépasse largement les standards internationaux (3 à 10 %).
- Les banques et les grands groupes en sortiraient gagnants, au détriment du tissu entrepreneurial.
- Les experts appellent à une révision rapide du dispositif.