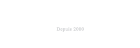Des eaux stagnantes d’un noir épais, des odeurs suffocantes, des plages désertées et des barques de pêche abandonnées…
Tel est le triste décor qu’offre aujourd’hui le golfe de Monastir, jadis havre de vie marine et de loisirs pour les habitants de la région.
Depuis plus de vingt ans, ce site emblématique vit sous la menace d’une pollution chronique, transformé peu à peu en une « zone morte » où la nature agonise sous le poids des rejets domestiques et industriels.
S’étendant sur 1 700 hectares et 31 kilomètres de côtes de Ras Monastir à Ras Dimass, le golfe abrite sept villes : Monastir, Khniss, Ksibet el-Médiouni, Lamta, Sayada, Teboulba et Bekalta.
Une zone autrefois riche d’une biodiversité exceptionnelle, où prospéraient poissons, algues et crustacés.
Mais cet équilibre écologique a volé en éclats sous l’effet d’une gestion défaillante et de politiques publiques jugées « inadaptées ».
Une mer sacrifiée à l’industrialisation
« Le golfe de Monastir est le miroir d’un modèle de développement prédateur », dénonce Mounir Hsine, président du Forum économique et social (FES) local. « Depuis les années 1990, les rejets des industries textiles et le déversement d’eaux usées non traitées ont provoqué une catastrophe écologique sans précédent. »
Constat corroboré par l’ONAS (Office national de l’assainissement). La station d’épuration de Lamta-Sayada-Bouhjar, construite en 1993, a largement dépassé sa capacité initiale.
Prévue pour 1 660 m³ d’eaux usées par jour, elle en reçoit désormais plus de 6 000.
Conçue pour trois villes, elle en dessert aujourd’hui six. « Nous fonctionnons à plus de 400 % de la capacité normale », reconnaît Rachida Cherada, responsable de l’analyse des rejets industriels à l’ONAS.
Les conséquences sont désastreuses : les eaux de ruissellement et les effluents domestiques se déversent directement dans le golfe, créant une nappe noire visible depuis les hauteurs de Monastir.
Pour les riverains, la situation est devenue insupportable. Les habitants de Ksibet el-Médiouni ou de Sayada racontent qu’ils se baignaient jadis dans des eaux claires où foisonnaient les poissons.
Aujourd’hui, ils vivent dans la crainte des maladies et de la dépréciation de leur environnement.
« Nous ne pouvons plus ouvrir nos fenêtres à cause des odeurs. Nos enfants souffrent d’allergies et de problèmes respiratoires », témoigne un pêcheur de Lamta, contraint d’abandonner son activité.
Des études locales ont mis en évidence une augmentation des maladies dermatologiques et respiratoires parmi les habitants et les travailleurs de la mer.
Face à cette dégradation, plusieurs associations ont réclamé de décréter l’état d’urgence environnemental et la mise en œuvre d’un plan d’action à court et long terme pour sauver le golfe.
Des responsabilités partagées
Le président de l’Union régionale de l’industrie et du commerce, Mustapha Ben Tekia, reconnaît que « la faiblesse du contrôle » contribue à la pollution.
« Les inspections ne concernent que les entreprises légales, alors que des centaines d’ateliers et de stations de lavage opèrent sans autorisation », précise-t-il.
Il cite le cas de 400 stations de lavage de voitures non agréées dont les rejets polluent davantage que vingt entreprises industrielles réunies.
Même les sociétés conformes sont parfois contraintes de rejeter leurs eaux sans traitement, faute de capacité suffisante des stations. Pour répondre à la crise, plusieurs projets ont été étudiés.
L’ONAS prévoit une nouvelle station modulaire à Lamta (1 000 m³/jour) et deux stations industrielles à Moknine et au pôle technologique de Monastir. Mais faute de financement, ces projets restent bloqués.
« Une étude lancée en 2002 et achevée en 2009 estimait le coût à 35 millions de dinars.
Aujourd’hui, il dépasse 125 millions », explique Cherada. Les dossiers techniques sont prêts et figurent parmi les projets prioritaires inscrits pour 2025, mais les fonds manquent encore.
L’État promet d’apporter des solutions
La question a pris une tournure nationale depuis la visite surprise du président de la République le 10 juillet 2025.
Se rendant sur les lieux, il avait dénoncé un « crime environnemental » et appelé à des mesures urgentes.
Il a rappelé que le droit à un environnement sain est garanti par la Constitution et que l’État a l’obligation de le préserver.
Le ministre de l’Environnement, qui a présidé un conseil régional sur le golfe, a confirmé l’avancement des études pour les stations de Lamta-Sayada-Bouhjar et du pôle technologique, assurant que les démarches de financement sont en cours.
Selon les autorités régionales, le coût total des projets dépasse 190 millions de dinars. Des réunions sont prévues pour débloquer les fonds et lancer enfin les travaux.
Mais pour les habitants du littoral, l’urgence est déjà là. Chaque jour de retard accentue la détresse d’un écosystème qui s’asphyxie.
Et au large de Monastir, la mer, jadis bleue et vivante, continue de noircir dans l’indifférence.