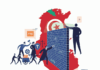Ce thème est dans tous les esprits. Et les Journées de l’entreprise ont été l’occasion d’une sorte de consultation nationale sur cette question cruciale. Elles contribueront à impacter le débat actuel qui se déroule à l’ARP (Assemblée des représentants du peuple) autour du Code des collectivités locales.
Mais l’intérêt implicite du symposium de l’IACE, effleuré à termes à peine voilés par Ahmed Bouzguenda, son président, est qu’à la différence des IDE (Investissements directs étrangers) qui dépendent de facteurs exogènes, la décentralisation est une affaire dont on a l’entière responsabilité.
Il le disait sans le dire que le pays, en matière de décentralisation, a une obligation de résultat. Cette conviction se nourrit d’un constat pratique : la décentralisation est le prolongement naturel du processus de développement.
Il a été occulté pendant longtemps. Il nous a causés tous les torts que nous connaissons. Cela va de la sous-performance économique jusqu’au sentiment regrettable et redoutable du démon du régionalisme.
L’heure est venue, il faut y aller. Les échanges ont permis d’esquisser une feuille de route. Et son apport est fait de pédagogie mais également d’un chemin de raison, c’est-à-dire un plan de réalisation dûment ficelé et profondément cohérent.
L’horizon incontournable de la décentralisation
Cela semble être un enseignement de de raison. La décentralisation est une tendance universelle, cependant, on ne cède pas à la tentation du mimétisme aveugle. Il ne s’agit pas de faire comme tout le monde. On voudrait implémenter cette initiative aux couleurs nationales, tant les impératifs de sursaut de croissance et de l’atténuation du déséquilibre régional sont pressants.

Le projet en préparation ampute les collectivités locales d’une fonction essentielle, celle de décider de nouveaux impôts. Qu’importe ! Un meilleur essor de recouvrement des impayés locaux ainsi qu’une extension d’assiettes avec usage de l’effet de base permettraient, momentanément, de desserrer la contrainte du plafonnement des recettes fiscales locales.
La proximité avec les élus locaux, une nouvelle passerelle vers une nouvelle forme de corruption. Les moyens de parade existent. La démocratie “concertative“ peut y pallier. Par ailleurs, ce sera un objet de pression pour accélérer le programme de «Tunisie digitale 2020» pour aller vers le e-gov. Ah !, restera la constitution des chaînes des valeurs locales. «Ne jamais injurier l’avenir», Charles de Gaule dixit.
Une intelligence locale pourrait s’activer l’un dans l’autre, la décentralisation s’annonce bénéfique. Elle pourrait charrier le risque de détricotage de l’Etat national. En démocratie, le peuple ne peut pas s’exonérer de l’obligation de veiller au grain.

Quand bien même les prévisions d’appoint de croissance qui naîtraient de la décentralisation restent, selon les prospectivistes, fort modestes (oscillant entre 0,35% et 0,60%), ce levier de la décentralisation doit être la planche de salut pour booster la réconciliation nationale et tourner définitivement la page de polémique sur les régions marginalisées.
En réalité, pour s’exprimer en langage sportif, il va falloir jouer sur les ailes. Les régions transfrontalières peuvent se convertir en plateforme de corrélation économique, avec la Libye à l’Est et l’Algérie à l’Ouest. Et dans cette perspective, on peut espérer restructurer l’économie tunisienne. La taille critique qu’elle pourrait atteindre et, peut-être dépasser, apporterait un tonus et un élan de punch qui laisse augurer d’une refondation économique avec l’espoir de mettre sur pied le nouveau modèle économique tant attendu.