
Nabi, titulaire d’un doctorat en économie de l’Université Paris I Panthéon Sorbonne en 2004, a été nommé membre indépendant de la Commission d’agrément de la BCT, en novembre 2016. Il avait, aussi, occupé le poste d’économiste supérieur au sein du groupe Banque islamique de développement (juin 2011 à novembre 2013).
Il a présenté son ouvrage à la conférence “Un livre – Un débat” organisée par l’Association DREAM, à la mi-novembre à Mahdia.
Interview.
Qu’est ce qui a motivé la publication de ce livre ?
Mahmoud Sami Nabi (MSN): Cet essai s’inspire des approches de développement multidimensionnelles d’Ibn Khaldoun et de Joseph Stiglitz.
Depuis 2011, nous sommes dans une phase particulière où interagissent des facteurs de dimensions diverses. Cette caractéristique commune des transitions politiques, est complexifiée, dans notre cas, par des problématiques d’ordre sociologique et historique, estompées avant 2011.
Pour pouvoir s’en sortir, les approches partielles ne sont pas suffisantes. Seule une approche de développement globale, intégrée et articulée autour d’un projet national, pourrait faire aboutir la transition tant démocratique qu’économique.
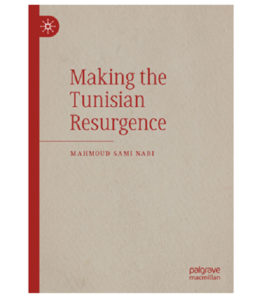
Quel diagnostic faites-vous, dans le cadre du livre, de la situation actuelle de l’économie nationale ?
MSN: J’ai consacré deux chapitres du livre pour mettre en lumière les facteurs socio-économiques ayant généré la révolution, les fractures sociales et les difficultés économiques que connait la société tunisienne.
Le diagnostic des faits historiques se base sur une riche littérature, évoquant un philosophe comme Mahjoub Ben Milad et les militants Hassine Triki et Ahmed Tlili, à titre illustratif, lorsque les questions de la place de la religion dans la société, le conflit Bourguiba- Ben Youssef, la dérive autoritaire de la postindépendance sont commentées …
L’accent est également mis sur les apports civilisationnels de la société tunisienne en matière de bonne gouvernance et de savoir à plusieurs époques, depuis Carthage, en passant par le pacte fondamental (Ahd El Amen) de 1857, les mouvements modernistes de Kheireddine Pacha, Abdelaziz Thâalbi, Bourguiba…
L’idée est qu’il faut arriver à une conception de la société où nos divergences ne doivent pas conduire à la polariser, mais plutôt à l’enrichir, en capitalisant sur cette diversité et faisant du savoir et de l’inclusion, la méta enveloppe qui catalyse les synergies.
La littérature nous enseigne à cet égard, qu’il y a des politiciens qui savent rassembler et fédérer autour d’un projet commun et d’autres qui font de la diversité de la société, un fond de commerce pour justifier leurs positions sur le terrain politique. La Tunisie a aujourd’hui, besoin d’une classe politique qui sait fédérer et tirer profit des divergences, au lieu de les exploiter pour fragmenter et fragiliser davantage la société.
Le livre fait aussi, un diagnostic économique en distinguant deux volets, le structurel et le conjoncturel. L’aspect structurel fait référence à la structure de l’économie tunisienne qui est assez résiliente et diversifiée, grâce aux secteurs de l’agriculture, des services (tourisme, transport, télécommunications, finance, commerce,…), de l’industrie (manufacturière et non manufacturière).
Toutefois, cette économie est arrivée à la fin des années 2000, au bout d’un chemin, où la croissance a été beaucoup plus tirée par l’accumulation des facteurs de production (facteur du travail) que par le progrès technique et l’innovation.
Et c’est assez paradoxal, parce que la Tunisie est bien classée sur le plan de la recherche scientifique académique et son système éducatif a formé sur plusieurs décennies, des compétences de haut niveau.
Le problème est que le pays n’a pas bénéficié du retour sur investissement intensif dans l’éducation depuis l’indépendance, étant donné la faible capacité de son économie, à absorber le savoir et à innover. Rappelons qu’aujourd’hui 20% des diplômés de l’université tunisienne résident dans des pays de l’OCDE.
Maintenant que nous sommes au bout d’un chemin, il faut transformer notre économie et profiter de ce que nous offre la révolution numérique, comme nouveaux vecteurs de développement socioéconomique.
Mais, il ne s’agit pas d’injecter des technologies numériques sur d’anciens modèles de création de richesse et d’organisation sociétale, mais de moderniser nos institutions et cadres réglementaires, d’améliorer notre climat des affaires et de libérer les potentiels énormes des tunisiens qui n’ont cessé de rayonner à l’international, et ce afin de permettre l’éclosion d’une nouvelle génération d’entrepreneurs innovants, et de permettre à notre tissu économique de se moderniser.
Cette transformation, facilitée par les technologies numériques, n’est pas facile à réaliser, car elle est perturbatrice des ordres et des règles de jeu, prédominants, amenant la transparence, la traçabilité, la redevabilité et de nouveaux mécanismes de prise de décision, où le participatif se substitue à l’autoritaire.
Cette gestion de changement nécessite un leadership fort, qui s’apparente à celui des périodes postindépendance, mais qui est de nature différente. C’est ce que j’appelle dans le livre, le leadership institutionnel dans tous les domaines.
A ce diagnostic structurel, s’ajoute le volet conjoncturel. Après 2011, l’économie nationale a subi des chocs énormes, extérieurs mais aussi, intérieurs.
Extérieurs en rapport avec le conflit libyen, la récession en Europe, l’augmentation des prix du pétrole et des matières premières…
Internes en rapport avec le contexte socio-économique, les grèves, la chute de la production du phosphate, le creusement du déficit énergétique, les attaques terroristes ayant impacté le secteur touristique, les augmentations de l’effectif dans l’administration publique, l’indexation des augmentations salariales sur l’inflation, dans une période où l’évolution de la productivité totale des facteurs est négative, le recours excessif des banques au refinancement de la Banque Centrale.
Tous ces facteurs ont eu pour conséquence, la baisse de l’investissement, de l’épargne et une détérioration de nos fondamentaux macroéconomiques (déficit courant, déficit public, endettement public), avec une inflation élevée et une dépréciation du dinar.
Comment mettre en place une telle stratégie de développement face aux besoins grandissants du pays en matière de financements ?
MSN: C’est la raison pour laquelle j’ai souligné dès le départ la nécessité de mettre en place tout un projet national fédérateur où la création de richesse et le progrès social sont couplés et les stratégies de financement, bien conçues.
Les capitaux étrangers privés sont de nature pro-cyclique. Si l’économie va bien, ils sont là et ils investissent. En situation de récession économique, la prime de risque augmente et il devient difficile de se financer, sur les marchés des capitaux internationaux.
Pour la Tunisie, la solution réside dans la recherche de ressources internes et externes moins coûteuses, qui peuvent accompagner cette phase délicate.
Pour les financements intérieurs, il est temps de concevoir des montages financiers basés sur la titrisation des revenus futurs, qui consiste à échanger des revenus futurs confirmés (comme le gazoduc algérien), contre un financement immédiat par les investisseurs.
Il s’agit de ramener des recettes futures au présent, à travers l’émission de certificats d’investissement . Les souscripteurs (investisseurs individuels ou institutionnels) obtiendront à travers ces certificats d’investissement, des rendements futurs qui auraient été perçus par l’Etat.
L’idée est non seulement, de chercher des coûts de financement moins chers, mais aussi de pouvoir lever des montants suffisamment importants pour pouvoir les canaliser vers des investissements publics à fort impact économique, par exemple, dans l’énergie renouvelable. De cette manière, on réalise plus qu’un objectif : on booste la croissance économique et on réduit le déficit énergétique.
La titrisation des revenus futurs pourrait être exploitée dans plusieurs domaines et pourra se faire dans le cadre d’un holding public. Dans le livre, je cite l’exemple de Tamasek Holding, créé par Singapour, dans les années soixante, comme une solution de compromis, face à l’opposition à l’époque, à la privatisation des entreprises publiques.
L’Etat pourrait aussi, émettre des certificats d’investissement sous forme de sukuks d’infrastructure (un véhicule de partenariat public privé), pour attirer des investisseurs internationaux intéressés par les grands projets d’infrastructure (solaire, centres hospitaliers, zones industrielles, ports…).
Mais, il faudrait également, continuer à améliorer les recettes fiscales, tout en réalisant une meilleure répartition de l’effort fiscal, une optimisation du recouvrement, une réduction de l’informel, une amélioration de la traçabilité des actifs extra-légaux et une lutte contre les sorties illégales de capitaux.
L’Etat peut encore, faire appel aux mécanismes de financement alternatif, tels que les obligations à impact social.
L’idée est de chercher des financements auprès d’investisseurs sensibles à des causes sociales spécifiques et qui ne sont pas forcément attirés par des rémunérations importantes mais par les causes elles-mêmes.
A cet égard, les fonds philanthropiques sont très utiles à mobiliser. Les obligations à impact social, sont des instruments financiers qui ont été lancés au Royaume-Uni en 2010, pour financer des programmes sociaux et ont par la suite, été appliqués dans plusieurs pays développés.
En Tunisie, plusieurs dons sont faits aux associations, sans qu’il y ait l’impact économique souhaitable, faute d’une bonne canalisation des dons reçus vers des projets concrets.
Il est souhaitable de créer une Instance indépendante de solidarité sociale, sous le contrôle du marché financier, qui structure ce troisième secteur de l’économie, devant être redevable au parlement et contrôlé par le conseil du marché financier.
Cette instance devra pouvoir lever des fonds pour réaliser des projets de développement socioéconomiques, en mobilisant des financements auprès d’investisseurs et de donateurs sensibles à des causes spécifiques (microprojets, aides aux familles nécessiteuses, logements sociaux, transport des écoliers et des femmes rurales, soins de santé, réhabilitation des écoles et des centres de soins, etc.), ce qui est de nature à lever une charge sociale importante sur le budget de l’Etat.
L’Etat pourrait aussi, exploiter la piste des obligations destinées à la diaspora ” Diaspora investment bond”. C’est vrai que l’expérience de l’emprunt national a été un échec, puisque l’Etat a été finalement contraint, à demander aux banques d’y souscrire.
Je propose donc de gérer autrement ce mécanisme, en présentant préalablement à la diaspora des projets concrets. Les Tunisiens à l’étranger, pourraient être motivés de les soutenir, dans leurs villes natales, par exemple.
Bien sûr, l’idéal serait de recevoir des financements en devises de tunisiens qui acceptent d’être remboursés en dinars tunisiens, au taux de change à terme. Cette économie des réserves en devises, est également, possible en réactivant la coopération entre banques centrales, à l’échelle maghrébine.
Dans le livre, je propose un mécanisme financier régional qui a été conçu avec des collègues dans la BID, et que l’on propose d’appliquer à l’échelle du Maghreb, pour financer le commerce et l’investissement.
L’autre idée que j’ai défendue dans le livre, est d’orienter la politique d’assouplissement monétaire de la BCT, vers des activités économiques ciblées, pour stimuler l’investissement et limiter la croissance de la masse monétaire, profitant aux dépenses de consommation (via le financement bancaire).
Il ne s’agit pas de faire fonctionner la planche à billet, mais de mettre en place des incitations, à travers les mécanismes du marché monétaire, pour financer l’investissement et le commerce extérieur. Ceci devient plus facile avec les technologies numériques, permettant une meilleure traçabilité de la circulation de la masse monétaire.
Pensez-vous que la classe politique actuelle pourrait mener un tel projet national?
MSN : Je pense que la question du politique et de l’économique est toujours posée pas seulement en Tunisie, mais aussi, dans d’autres pays ayant des traditions démocratiques, bien ancrées. Le politique est toujours contraint, par des gains de court et moyen termes. Or, une stratégie de développement nécessite une vision à long terme et une certaine continuité dans la conduite des orientations économiques. Cela nécessite un contrat de confiance, basé sur une nouvelle réorganisation des interactions entre les différents acteurs (Etat, secteur privé, partenaires sociaux et société civile), avec des coûts de court terme bien répartis, contre des gains espérés de plus long terme, bénéficiant à l’ensemble de la société.
Cela ne pourra se faire, sans une stabilité institutionnelle, portée par un leadership institutionnel capable d’assurer la visibilité des orientations socioéconomiques, face aux changements des équipes gouvernementales, aux coalitions politiques instables et aux différentes sortes d’arbitrages.
Dans le domaine économique, l’expérience sud-coréenne est édifiante. Elle a mis en place, depuis les années 60, le “Korea Development Institute”, une sorte de think tank étatique qui élabore les stratégies de développement sur 15 à 30 ans, assurant ainsi la continuité de l’Etat, indépendamment des changements politiques.
On peut imaginer une institution pareille, capitalisant sur le Conseil d’analyses économiques, l’ITES et toutes les structures publiques de l’intelligence économique, mais également sur l’expérience du Conseil économique et social (CES), mais qui soit libérée de l’emprise de l’exécutif.
Vous avez évoqué la nécessité de l’intégration internationale de l’économie nationale. Par quels mécanismes, cette intégration vous semble possible ?
L’intégration de l’économie tunisienne dans l’économie internationale, est fondamentale, mais elle devra être faite de manière intelligente. Il va falloir faire des choix stratégiques et développer des stratégies sectorielles articulées autour de notre coopération internationale.
Il faut avoir des partenaires motivés par l’accompagnement de notre transition technologique, dans des secteurs prioritaires, tels que l’énergie renouvelable, le dessalement de l’eau de la mer et tout ce qui concerne les ressources en eau, l’agriculture, l’intelligence artificielle et la science des données, le tourisme de haut de gamme, les services de santé et l’industrie pharmaceutique, les industries mécanique, électrique et électronique…
Il faut arriver à identifier 6 ou 7 segments de forte spécialisation, auxquels on doit réussir à associer des partenaires internationaux, en fonction de leur spécialisation et bénéficier à cet égard, de l’énorme potentiel de notre diaspora.
Autour de ces secteurs prioritaires, tout un écosystème d’éducation et de R&D, entrepreneuriat et finance, devra être conçu en bénéficiant des meilleures pratiques internationales en matière d’architecture institutionnelle et de gouvernance.



