
Au ministère de l’Equipement, il est dans son élément. Tout est à construire en Tunisie, aussi bien les routes, les autoroutes que les structures mentales…
Entretien
WMC : Lorsque l’on parcoure votre carrière professionnelle, on réalise que vous avez, dans le cadre de votre mission à la BM, travaillé dans nombre de pays en transition. Pourquoi la transition tunisienne semble-t-elle si difficile? Qu’est-ce qu’elle a de spécial?
Hédi El Arbi : Nous en sommes aujourd’hui à notre quatrième année de transition. Et pour l’instant, je dirais que nous nous situons encore à un stade tolérable dans ce que nous pouvons appeler “les transitions moyennes“. Nous n’avons pas traversé une transition courte qui a rapidement réussi et nous n’avons pas encore atteint les limites d’une longue transition qui s’est perdue dans la nature.
En général, les transitions d’un régime à un autre s’étalent sur trois à cinq ans. La transition tunisienne tombe dans une sorte de durabilité probablement à cause du fait qu’elle a été rapidement idéologisée. Elle a pris une tournure idéologique parce que, entre autres, la culture économique des Tunisiens est faible et l’apprentissage et la maturité politique sont également faibles.
Il y a eu une toute petite période de familiarisation avec les nouvelles donnes en place, et tout de suite après, le politique a pris le pas parce que c’est plus facile à maîtriser.
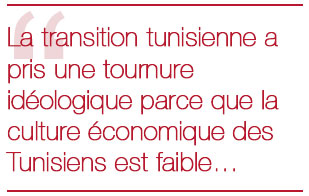

Le Tunisien n’étant pas habitué aux joutes politiques et ne sachant pas pourquoi il fallait distinguer les deux approches, l’approche démocratique, la sécurité et la citoyenneté des impératifs socioéconomiques et même identitaires, n’a pas pu voir clair dans tous ces imbroglios.
En fait, c’est pour la première fois qu’on remet en cause notre modèle social tel que nous l’avons toujours vécu tout comme nos spécificités tuniso-tunisiennes.
Exactement. Deuxième élément important à savoir, c’est que pendant l’année 2011, notre pays n’était pas en si mauvaise posture, économiquement parlant. La situation était difficile, mais pas mauvaise. Et si nous faisions la comparaison avec la transition en Europe de l’Est ou l’Amérique latine qui date de trente ans déjà, nous remarquerions tout de suite des différences de taille. Ces pays étaient dans une situation économique très difficile en comparaison avec la nôtre. Le peuple était conscient de la gravité de la conjoncture. Les leaders politiques, réactifs dans ces pays, ont très vite réalisé la nécessité de passer rapidement des discours politiques à la recherche de solutions économiques.
En Tunisie, nous avions un matelas de plus de 5 milliards de dinars de réserves au niveau fiscal, notre croissance était de 3,5 à 4% et il y avait une dynamique économique. Qu’est-ce qui s’est passé? Nous avons exploité les ressources que nous avions pour calmer le peuple et acheter la paix sociale. Sauf que cette transaction s’est avérée très chère, et aujourd’hui, nous avons du mal à assurer parce que les ressources sont devenues moindres. Et je dirais même qu’il est devenu très difficile de payer encore plus pour avoir la paix sociale.
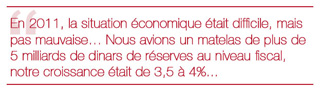
Pour résumer, la transition a pris une tournure idéologique très forte et je dirais très polarisante dès le départ. La situation économique qui, elle, n’était pas très mauvaise, avait donné du répit aux politiques pour pouvoir se payer le luxe de tenir une ou deux années sauf qu’aujourd’hui nous ne pouvons plus nous payer ce luxe.
Ce qui nous amène à la question suivante. Vous êtes arrivé avec un plan d’action, le temps de vous rendre compte de réalité de la situation, considérez-vous que vous avez toujours les moyens de concrétiser ce plan d’action? Pour ce qui est des entreprises sous tutelle, est-ce qu’elles sont aussi déficitaires que les autres dans d’autres ministères? Et où en êtes-vous pour ce qui est des projets d’infrastructures, des méga projets et des logements sociaux? Comment les choses se présentent pour vous?
Très bonne question. Tout d’abord, il faut prendre deux ou trois semaines quand on a de l’expérience, pour bien comprendre le secteur et mettre en place une stratégie de relance. Ceci étant, au départ, nous sommes plutôt concentrés sur la dynamique interne de l’institution, le ministère et les entreprises sous tutelles. Nous nous sommes très vite rendu compte que la contrainte la plus lourde à supporter est celle des pressions extérieures.
Si je prends l’exemple de mon ministère, je vous dirai qu’au sommet de nos préoccupations figurait le programme de construction des routes et des autoroutes et celui des habitats sociaux. Nous avions un nombre d’investissements dans des projets de lutte contre les inondations, un programme pour la rénovation et la réhabilitation des quartiers délabrés, et nombre de nos entreprises publiques ne souffraient pas autant.
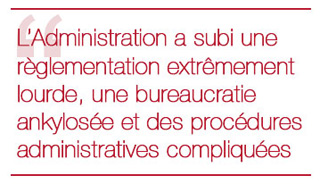
Le plus grave est toutefois la faiblesse de l’exercice de l’institution et celle de sa capacité à travailler proprement. L’institution a été fragilisée pendant la révolution. Pas de restructuration, pas de recrutements et pas de motivation. On n’a pas non plus créé des procédures de travail avancées et à même de contribuer à la croissance économique.
L’Administration a subi une règlementation extrêmement lourde, une bureaucratie ankylosée et des procédures administratives compliquées. Il fallait donc d’ores et déjà travailler sur les contraintes institutionnelles, pour remotiver le personnel, restructurer les départements et simplifier les procédures au possible. Car quoiqu’on prétende, et bien qu’il ne soit pas facile de surmonter certaines réglementations administratives, on se rend compte tout de suite après que c’est l’environnement social qui constitue un obstacle à la performance des entreprises.
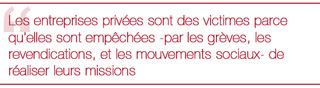
Les entreprises privées sont des victimes parce qu’elles sont empêchées -par les grèves, les revendications, et les mouvements sociaux- de réaliser leurs missions. En fait, elles travaillent sur la base de cahiers de charges qui déterminent leurs champs d’action et des fois, elles signent des contrats ou des conventions pour des marchés sur la base de certaines données lesquelles ne sont plus d’actualité à cause des mouvements sociaux. Conséquences: ça les retarde et nous retarde.
Il y a aussi la question de coordonner sur le plan procédural avec les autres institutions de l’Etat et particulièrement dans le foncier, ce qui n’est pas facile à résoudre. Cela enfreint aujourd’hui une évolution beaucoup plus rapide dans la réalisation de nos projets et non seulement la difficulté de la conjoncture mais la gestion des problèmes extérieurs à l’institution et celle des réformes que nous voulons apporter à l’intérieur de l’institution elle-même.
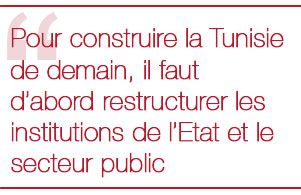
Vous êtes l’Etat, le gouvernement c’est un peu l’Etat. Quand certains travaillent et d’autres viennent les empêcher de le faire, ceci a pour conséquence des pertes que les contribuables paient de leurs propres poches. 4 ans après le 14 janvier, l’Etat n’est toujours pas présent. Ne pensez-vous pas qu’il est grand temps pour qu’il reprenne sa place et sa prépondérance pour servir l’intérêt public et celui des contribuables au risque de devenir réellement une République bananière?
Bien évidemment. Vous avez certainement entendu le chef du gouvernement en parler. Il n’a pas cessé d’insister sur la valeur travail et l’autorité de l’Etat. L’autorité de l’Etat est fondamentale. Je comprends personnellement, en tant que citoyen, qu’en 2011 et au début 2012 on ait eu besoin de gérer un climat social et sécuritaire vulnérable, pour avancer un peu dans la transition et mettre en place les institutions démocratiques et la Constitution. Mais je pense qu’à partir de 2013, on aurait dû rappeler qu’une démocratie, c’est aussi des devoirs, des obligations et un Etat de droit.
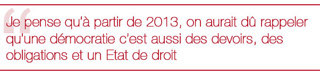
La justice doit protéger aussi le service public. Si certaines personnes abusent de leurs droits et violent le service public, il faut qu’ils soient traduits devant la justice. Nous ne pouvons plus nous permettre de laisser des personnes barrer les routes ou empêcher des entreprises de travailler. La loi doit sévir et la justice doit régner. Il y a des lois qui interdisent ces comportements. S’il y a des revendications, il faut recourir aux circuits légaux qu’il s’agisse des créneaux administratifs, des institutions représentatives ou des tribunaux qui peuvent résoudre tous les problèmes dans la légalité et le respect de la loi.
En ce qui nous concerne, nous entretenons de bonnes relations avec les syndicats mais cela n’empêche pas les grèves sauvages déclenchées sans aucune raison légale… Tout en étant ouvert au dialogue, il faut être ferme dans l’application de la loi.
Pour revenir justement au monopole des entreprises sous tutelle, quelles sont les entreprises qui devraient être ouvertes au capital privé et comment faire en sorte que le partenariat public/privé réussisse dans un secteur comme le vôtre qui a, entre autres responsabilités, celle de gérer les grands travaux?
La Tunisie a dix à quinze ans de retard en matière de réformes structurelles. Nous n’aurions pas dû garder un aussi grand nombre d’entreprises publiques à ce jour. Sachant que les secteurs dans lesquels la plupart de ces entreprises évoluent sont des secteurs ouverts et hautement compétitifs.
Prenons l’exemple de l’habitat, nous avons nombre de sociétés publiques opérant dans le bâtiment, il y a un grand nombre de promoteurs immobiliers, des particuliers qui construisent eux-mêmes leurs propres résidences et d’autres qui vendent des terrains. Nous ne pouvons donc pas préconiser que c’est un secteur stratégique. Son importance pour nous en tant qu’Etat varie selon qu’il s’agisse d’habitat social destiné aux couches les plus vulnérables ou non.
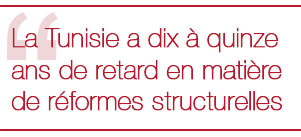
Ce qu’il faut, c’est plus d’efficacité de la part de tous les acteurs, qu’il s’agisse d’acteurs privés ou publics. Quand j’ai dit que nous avons un retard de 10 ou quinze ans en matière de privatisation d’entreprises publiques, c’est parce que nous aurions dû les entamer en l’an 2000 en ouvrant le capital au secteur privé. L’objectif à atteindre était que ces entreprises publiques soient devenues totalement privatisées et autonomes. Aujourd’hui, elles sont à plaindre, parce que nous leur imposons des contraintes qui mènent directement à leur perte.
Nous nommons à leurs têtes des PDG et nous ne nous posons même pas la question de savoir si ce sont de véritables managers. Le conseil d’administration est désigné à partir de l’Administration centrale et non pas par de bons gestionnaires qui viennent appuyer la direction générale et l’aider à concevoir les stratégies, les plans d’action, à restructurer, mettre à niveau le management et améliorer la productivité et la situation financière de l’entreprise.
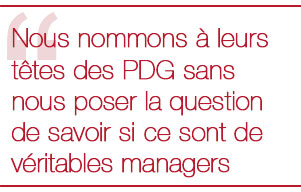
Le coût de ces choix populistes est la faillite de ces entreprises. Pour ne pas en arriver là, l’Etat les renfloue en capitaux, mais d’où viennent ces capitaux? Du contribuable. Chaque assainissement ou restructuration coûte cher aux contribuables alors que si l’on avait procédé autrement, au lieu d’assainir, on aurait investi cet argent dans d’autres projets plus productifs, des services sociaux ou autres.
Les détracteurs d’une privatisation progressive des établissements publics pensent que la Tunisie va céder ses possessions aux privés, et que nous risquons une nouvelle colonisation… Ce sont de gros clichés, exprimés par des personnes qui feignent d’ignorer que globalisation oblige, les grandes puissances idéologiquement socialistes et mêmes communistes se sont libéralisées. Prenons l’exemple de la Chine qui a triplé le Smig sur trois ans. Est-ce qu’elle a continué à suivre une politique socialiste ou plutôt parce qu’elle a changé d’option? Que répondre à ces arguments?
Il y a d’abord des arguments économiques et sociaux mais il y a aussi le politique qui est fondamental. Il faut faire attention à cela. L’argument économique pur nous dit que si nous libéralisons le pays et mettons en place les réglementations qui s’imposent, renforçons les institutions pour qu’elles puissent gérer les différents secteurs avec compétence et efficience, nous pourrons gagner le pari d’une économie au service de l’homme. Il faut simplement veiller à la bonne application des règles de la concurrence, nous aurons ainsi un meilleur service pour un coût moins élevé pour l’ensemble de la population.
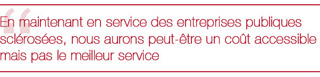
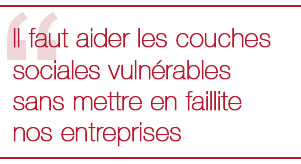
Faut-il garder les entreprises publiques de peur d’être colonisés? Non, d’abord parce qu’aujourd’hui, il y a un secteur privé tunisien et des groupes capables d’acheter ou de rentrer dans le capital de ces entreprises. Et d’ailleurs pourquoi pas des entreprises étrangères qui apportent avec elles le savoir-faire, le bon management, la technologie et nous apportent aussi la possibilité d’exporter et donc de créer des emplois pour les Tunisiens.
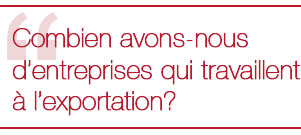
Nous voyons partout des sociétés publiques (françaises, suisses ou chinoises) qui travaillent à l’exportation, combien avons-nous d’entreprises qui travaillent à l’exportation? Elles n’ont même pas des ressources financières pour aller explorer des marchés ailleurs. Donc on voit bien ce que nous perdons.
S’il y a un pays socialiste qui veille à la préservation de ses actifs donc de ses entreprises publiques, c’est bien la Chine. C’est un pays extrêmement intelligent qui a compris que ce n’est pas par le maintien en vie de l’entreprise publique que sa politique sociale est reflétée mais par le maintien d’une entreprise performante qui exporte et qui crée de l’emploi et de la valeur pour l’économie. Dans tous les secteurs publics où ils ont des entreprises publiques, les Chinois ont ouvert le marché et leur ont posé un ultimatum: «où vous arrivez à soutenir la concurrence des entreprises privées puisque je libéralise le secteur ou disparaissez».
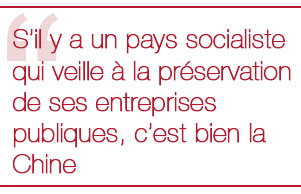
Les Tunisiens sont ambitieux et réussissent quand ils partent à l’étranger. Il n’y a aucune raison pour qu’ils ne réussissent pas chez eux..




