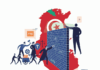Souveraineté alimentaire: “L’Afrique ne doit pas être un terrain d’essai pour la biodigitalisation”
“L’Afrique ne doit pas être un terrain d’essai pour la biodigitalisation impulsée par les entreprises”, ont laissé entendre les participants à la première réunion panafricaine sur l’avenir des technologies biodigitales dans l’alimentation et l’agriculture, qui s’est tenue à Addis-Abeba, en en Éthiopie, début octobre 2025.
Plus de 130 participants de 33 pays africains ont pris part à cette réunion, co-organisée par l’Alliance pour la souveraineté alimentaire en Afrique (AFSA), la Plateforme africaine d’évaluation des technologies (AfriTAP) et le groupe ETC.
“Les technologies ne sont pas neutres, elles reflètent et reproduisent les systèmes de pouvoir (…). Elles ne devraient être utilisées que lorsqu’elles peuvent faire progresser la souveraineté alimentaire et l’agroécologie, qui doivent être le fondement de l’avenir de l’Afrique à l’ère numérique. Nous affirmons la nécessité de technologies non extractives, co-créées avec les communautés et fermement ancrées dans les droits humains”, selon la déclaration panafricaine sur l’avenir des technologies biodigitales dans l’alimentation et l’agriculture.
La justice en matière de données et la souveraineté semencière sont des droits non négociables des agriculteurs et des communautés. La solidarité panafricaine et la collaboration Sud-Sud sont essentielles pour résister à l’emprise des entreprises. L’innovation locale doit être privilégiée par rapport aux solutions “high-tech” imposées, d’après les participants au conclave d’Addis Abeba.
Pour l’Afrique, ces technologies présentent des risques évidents : appropriation des ressources génétiques et des données par les entreprises, exploitation écologique, utilisation massive d’énergie et d’eau avec des émissions climatiques très importantes et une extraction minière nuisible, surveillance accrue des gouvernements, accaparement des terres et de l’eau, déqualification des petits agriculteurs, vulnérabilité des connaissances traditionnelles et autochtones, et exclusion des femmes et des jeunes.