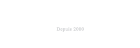1911 : la Joconde disparaît
Le 21 août 1911, Vincenzo Peruggia, ancien employé, soustrait la Mona Lisa du Salon Carré. Le tableau est retrouvé en Italie en décembre 1913. L’affaire, très médiatisée, renforce durablement la sécurité du musée.
Années 1907–1939 : l’ère des « petits objets » et l’affaire Watteau
En 1906–1907, le Belge Géry Pieret vole des antiquités ibériques, profitant d’une sécurité lacunaire. En 1939, L’Indifférent de Watteau est dérobé puis restitué après l’aveu du peintre Serge Bogousslavsky.
1990–1998 : vols ciblés et faille d’inventaire
En juillet 1990, un petit Renoir est découpé de son cadre ; un inventaire révèle l’absence de 12 bijoux romains anciens. En mai 1998, Le Chemin de Sèvres (Corot) est volé au mur ; l’œuvre n’a jamais été retrouvée. Ces incidents provoquent audits et réformes sécurité.
2025 : braquage en bande organisée des bijoux de la Couronne
Le 19 octobre 2025, quatre malfaiteurs utilisent un engin élévateur pour accéder à la Galerie d’Apollon, fracturent deux vitrines et emportent huit pièces de bijoux historiques en 4 à 8 minutes. Un diadème d’Eugénie est abandonné ; le diamant Régent reste en place. L’enquête, confiée aux unités spécialisées, privilégie la piste d’une équipe structurée.
Tendances observées
Cibles : des peintures « iconiques » (1911) puis, de plus en plus, des objets portables monétisables (bijoux, petites antiquités).
Modes opératoires : du solitaire opportuniste (1911) à la bande organisée, logistique légère et fuite motorisée (2025).